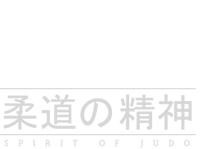Champion de caractère devenu homme d’affaires et de réseaux, le huitième dan est l’autre moustache la plus célèbre du judo français. Rencontre avec une institution, capable de murmurer à l’oreille du président de la FIJ sans jamais oublier le sous-sol familial d’où tout est parti il y a maintenant quarante-cinq ans. Une success story qui a rapidement dépassé les frontières hexagonales.

Bleu, blanc, noire
Je suis né six mois après la débâcle de 1940. Mon père était ouvrier agricole. Il ressemelait mes chaussures avec des morceaux de pneus. À l’âge de quatorze ans, il m’a mis à l’usine, qui jouxtait un club de judo. Ma première licence fut donc au JC Pontoise où le professeur Jacques Thieulaine, un Normand très simple, m’a prêté mon premier judogi. Le club était plutôt bourgeois. Avec mon bleu de travail, je détonnais quand je garais mon vélo devant… J’ai obtenu ma ceinture noire en deux ans. Même si nous ne venions pas des mêmes milieux, les gars du club m’ont d’autant plus vite adopté que j’ai vite su tenir debout sur le tapis, pour le dire comme ça (sourire). En janvier 1961, je pars en Algérie avec le bataillon de Joinville. Le général de Gaulle ne rigolait pas avec la guerre. Neuf mois d’armée et de sport, mais pas de judo. Je suis rentré fin octobre, un mois et demi avant les championnats du monde de Paris. Ce fut trop juste pour prendre part à cette compétition où le Néerlandais Geesink s’imposa face aux Japonais, comme une répétition avant son exploit aux Jeux chez eux.
Gros titre
Après la déculottée des JO de Rome en 1960 (la France termina 25e nation avec cinq médailles et aucun titre, NDLR), le général de Gaulle avait créé un statut spécial qui nous mettait à la disposition de notre fédération tout en ayant la possibilité d’encadrer l’AS Préfecture de police… Mon titre européen de 1963 à Genève a été retransmis le samedi soir en direct en eurovision avec Léon Zitrone aux commentaires, même s’il n’y connaissait rien ! Bien des années plus tard, Jean-Luc (Rougé) m’a dit en souvenir de cette soirée que j’étais son idole. En finale des -80kg, je bats en quarante secondes Georges Kerr, un Britannique qui venait de passer quatre années dans les universités japonaises. L’année suivante je fais deuxième, puis troisième la fois d’après, en toutes catégories cette fois.
Une carrure bien remplie
En 1965, je construis ma maison. J’ai alors deux clubs puisque j’en avais créé un second à Pontoise avec Roger Forestier, vice champion d’Europe 1962. Je décide de donner la priorité au travail, en parallèle de mes propres entraînements. Les résultats s’en ressentent et déjà s’amorce la seconde partie de ma carrière. Celle-ci s’étirera jusqu’en 1972. Avec mon hane-goshi et mon ne-waza, et malgré l’émergence de l’URSS et des pays de l’Est, j’ai été plusieurs fois champion de France, ai cumulé un record de soixante-deux sélections dont neuf en championnats d’Europe, deux en championnats du monde, des victoires de prestige en coupe d’Europe des clubs, au tournoi de Paris, et même aux championnats d’Allemagne, et la fierté d’avoir tenu la dragée haute à des clients comme Coche, Auffray, Grossain, Le Berre ou Clément (sourire) ! Nous pouvions enchaîner jusqu’à une heure et demie de randoris d’affilée. Mes trois années au top, je perdais cinq kilos par jour, soit un par heure d’entraînement. J’étais sec et j’avais la rage de vaincre.
Transmission, première époque
Comme professeur de judo, avec tous ces clubs que j’ai ouverts et dont je me suis occupé dans l’Oise et le Val d’Oise (Pontoise, Beaumont-sur-Oise, Cergy, Auvert/Oise, Magny-en-Vexin…), j’ai eu la fierté de voir plusieurs de mes élèves passer de la ceinture blanche à des titres nationaux, voire européens. À Cergy, le club compte aujourd’hui quatre salles, 800 licenciés et une dizaine de professeurs dont plusieurs sont les élèves de mes élèves. C’est une vraie fierté de voir ainsi durer et se développer dans le temps des structures que vous avez lancées.

Belle-île en mer
Parmi mes grandes fiertés, il y a bien sûr le stage d’Oléron. En 1963, il était à Pertuis, dans le Vaucluse, avec Armand Desmet puis, au bout de cinq ans, en Avignon, avant, cinq nouvelles années plus tard, de saisir l’opportunité de nous poser en Charente-Maritime. L’aventure durera quarante ans. Six semaines de stage, jusqu’à mille cinq cents personnes sur le tapis venues du monde entier, des cours en cinq ou six langues, une compétition à chaque fin de semaine dont une mémorable finale Parisi/Van de Walle – c’est d’ailleurs chez nous qu’Angelo a rencontré celle qui deviendra la mère de leur fils Vincent et contribuera à son changement de nationalité ! Et puis, en 2015, j’ai décidé d’arrêter. Mon épouse était sur le pont de six heures à minuit tous les jours, sur ses propres congés. Ma décision était prise.
SFJAM
En 1974, j’étais le professeur d’un bon millier d’élèves. J’achetais mon matos chez les deux grosses enseignes de l’époque, et puis les chocs pétroliers sont arrivés. En une semaine, le prix du tatami a été multiplié par deux. J’ai alors décidé de monter mon entreprise et de fabriquer mes propres équipements. À l’époque, nous étions dans le sous-sol de ma maison. Puis nous nous sommes rapprochés de la société Recticel, le plus grand fabricant de mousse polyuréthane du monde. Notre intérêt était commun : eux avaient un tiers de perte dans ce qu’ils produisaient en literie et sièges d’automobiles. Nous, nous récupérions ces chutes pour en faire de la mousse agglomérée. L’économie était substantielle ! Et comme je connaissais les mondes du judo et du karaté, de Jacques Delcourt à Francis Didier, les débouchés ont vite été là et nous ont permis de nouer des partenariats tant nationaux – les 2500 m2 de tapis de l’INSEP, c’est nous – qu’internationaux (JO, mondiaux, etc.). Côté production, si les tapis se fabriquaient principalement en Auvergne, l’Asie est vite devenue un enjeu pour les vêtements. J’ai travaillé avec la Corée, le Pakistan, Taïwan, des pays qui nous permettaient d’augmenter nos marges, tout en étant attentif à proposer un niveau de revenu décent… Là aussi, du fait de ma notoriété, le développement a été foudroyant. Des vieux de la vieille se sont rapidement proposés pour me représenter au plan local, avec cette idée d’un concessionnaire dans chaque région.
Transmission, seconde époque
Au fil des décennies, la Société Française de Judo et d’Arts Martiaux (SFJAM) est devenue incontournable. Nous sommes une quinzaine de collaborateurs à Cergy, et tout un réseau de revendeurs en France et en Europe. L’âge avançant (Il a 78 ans, NDLR), je me suis évidemment posé la question de céder ce patrimoine à un de mes neveux mais… renseignements pris auprès des banques, j’allais me retrouver obligé de verser 3,5 millions d’euros de taxes et d’impôts à l’État ! Après presque cinq décennies de travail, deux week-ends sur trois sur des stands ou des salons, jamais moins de soixante-dix heures par semaine pour moi, mon épouse et même ma première épouse ? Non mais plutôt crever quoi, c’est juste de la spoliation ! Alors je continue, comme je l’ai toujours fait. Mon investissement comme compétiteur m’a valu une prothèse de genou. Mon investissement comme professeur m’a coûté un divorce. Que restera-t-il de mon investissement comme entrepreneur ? Les sourires d’Oléron, forcément. Et aussi cette conviction profonde de m’être toujours battu pour essayer de tirer mon épingle du jeu. Le reste, tout le reste, ce n’est plus de mon âge d’essayer de changer ça.
Propos recueillis par Anthony Diao | Photos : Emmanuel Charlot
Remerciements : Frédérique Vitrac
À nos lecteurs : cet article est paru en septembre-octobre 2019, dans L’Esprit du Judo n°82.