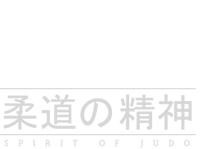L’Esprit des Jeux #2
Par Emmanuel Charlot
Ceux qui ont l’habitude de se rendre au Japon le savent : la gestion du décalage horaire n’est pas une mince affaire. Sept heures, c’est l’obligation de se coucher raisonnablement à 17h heure française (il est alors minuit ici) et, pour ceux qui, comme moi, ont un peu des habitudes d’animal nocturne, ce n’est pas gagné. Mais en général, quand on voyage au loin, les activités de la journée font office de levier. On ressent moins la fatigue quand on prend le métro, quand on se déplace ici ou là, les yeux attirés par toutes les curiosités de Tokyo, devantures amusantes ou exotiques, jeunes filles habillées en personnages de manga, bar à chats… Nous aurions d’ailleurs de quoi flâner dans ce quartier sympathique d’Ikebukuro qui nous propose un « spot » assez typique de Tokyo, une petite zone piétonne très active autour d’une rue centrale, laquelle relie deux grands boulevards, surplombé pour l’un par des voies rapides routières et des chemins de fer.


Mais c’est plus compliqué quand on est astreint au confinement strict dans sa chambre. Avec les rideaux fermés, pour préserver la fraîcheur obtenue par la faible climatisation de l’hôtel, le temps est un peu suspendu depuis deux jours. Il y a le test salivaire quotidien qui consiste, assis sur son lit, à cracher dans une fiole avec une paille (à l’aéroport, c’était un entonnoir) avant de descendre remettre le précieux crachat à deux assermentés dans le hall. Une à deux sorties pour aller faire quelques provisions, acheter un « take away » rapide, borné par la limite d’un quart d’heure qui nous est impartie comme pour une promenade carcérale. Nous croisons parfois d’autres habitants de l’hôtel, comme ce journaliste belge resté dix heures à Haneda, mieux que celui de Libération et ses neuf heures. Le reste du temps, nous sommes dans notre petit univers réduit à quatre murs, encombré de nos affaires, suspendu à nos écrans de portable, de mobile et la télévision. La NHK nous montre des images des porteurs de la flamme, un Japon provincial, celui des bords de mer, pêcheurs, ramasseurs de coquillages, agriculteurs d’algues, musiciens traditionnels, montreur de marionnettes, nageuses à ombrelle… sans doute plus ce qu’est vraiment le pays que l’image de verre et de métal que projette Tokyo sur le monde. Cet ancien marathonien ostéopathe qui sort précautionneusement de son étui le support métallique de la flamme, qu’il va bientôt brandir pour le montrer à ses patients nonagénaires tout émus, est bien touchant.
Depuis deux jours, les nuits ont tendance à ne durer que trois heures et les siestes… plutôt quatre. Nous tentons de profiter de ces courts moments à l’air libre, malgré le planton à casquette qui nous demande de noter systématiquement nos heures de sortie et de retour, pour prendre un peu le pouls des rues avoisinantes, goûter quelques bonnes choses. Cela ne va pas sans risque. L’autre soir, les barquettes achetées un peu trop vite à un marchand ambulant s’étaient avérées porteuses d’un genre de beignets de poulpe à la pâte indéfinissable et la sauce… tout autant. Il fallait aimer. Je n’ai pas fini la mienne, mais mon collègue Antoine, un Breton, n’a pas fait la fine bouche. Le lendemain, les tonkotsu ramen (soupe de nouilles au bouillon d’os de porc), même mangés dans la chambre de l’hôtel, étaient parfaitement savoureux.

Comme dirait Louis XVI le 14 juillet 1789 : « aujourd’hui, rien ».
En fait, c’est la veillée d’armes. Les acteurs sont en place. On reçoit parfois le message d’un coach — les Français sont partout, notamment auprès des pays africains — On se prépare. Mais tandis qu’on peut suivre à la télé les Japonaises faisant match nul avec les Canadiennes en football et battant d’un point les Mexicaines en softball, on voit aussi les cas de positivité s’accumuler au village. Une merveilleuse idée née en 1924, ce village, mais peu pertinente en cas de pandémie mondiale. L’équipe de football sud-africaine, une gymnaste américaine, un joueur de beach-volley tchèque vacciné et sans symptôme, une taekwondoïste chilienne, Fernanda Aguirre, qui sera, triste postérité, la première personne qualifiée aux Jeux à devoir y renoncer officiellement, malgré, elle aussi, toute absence de symptômes. On peut craindre qu’elle ne soit pas la dernière. Pire encore. Se retrouver cas contact la veille de son épreuve et ne pas pouvoir y participer, par précaution. Les couloirs sont déserts en ce moment au village, et les lits en carton, dits « anti-sexe », ne craignent pas grand-chose pour leur structure. On en vient à espérer que ce ne soit plus le cas au fur et à mesure que les épreuves seront derrière les athlètes, mais ce n’est pas sûr. Il y a un retour au pays à préparer. A-t-on jamais fait plus délétère que l’ambiance sanitaire actuelle pour casser l’esprit de partage et d’échange propre aux Jeux ? Le sport international, si puissant qu’aucune idéologie n’est totalement parvenue à l’amoindrir à moins d’annuler les épreuves, ni à détourner à son profit sa force symbolique, mène une bataille à mort, non pas contre un risque idéologique, mais contre un ennemi mortel qui l’étreint et menace de l’étouffer. En 1936, le sprinteur et sauteur en longueur allemand Luz Long, avant de devenir son ami et, malgré tout, de mourir au front en 1943, était allé féliciter Jesse Owens pour sa victoire au saut en longueur, cela au nez et à la barbe du chancelier allemand Adolf Hitler – et aussi, on oublie souvent de le préciser, de l’idéologie ségrégationniste américaine en place jusque dans les années 1960. Mais aujourd’hui, distances sociales obligent, Luz Long ne pourrait pas fréquenter Jesse Owens au village (celui de 36 était le troisième de l’histoire à être mis en place), ni venir lui taper sur l’épaule pour lui montrer son respect.

J’ai déjà vécu cinq Jeux olympiques — le journaliste a cet avantage sur l’athlète qu’il peut revenir plus souvent. Ce qui se passe à Tokyo à l’heure actuelle ressemble plus à une survivance de cette prestigieuse fabrique de grands moments historiques, une ombre, devenue manifestement embarrassante, pour le pays qui l’organise et se retrouve en but aux réticences d’une population méfiante et maussade, pour les organismes de santé internationaux qui n’y voit qu’un potentiel cluster géant et un hub effrayant de contamination mondiale. L’immense rendez-vous planétaire, socle de la civilisation occidentale, réduit à l’état de camp retranché, isolé du pays et reconstitué en studio… Sans public, il n’y a plus que la télévision pour nous donner à voir le spectacle et ce n’est plus pareil.
Les Jeux, c’est nous. C’est notre souffrance qui est donné à voir à travers tant d’aléas. Peuvent-ils ne pas aller au bout ? Être abandonnés avant la fin en cas de mauvais drame ? On en parle toujours. Leur chute serait la nôtre.
Élucubrations de chambre d’hôtel et de rideaux fermés, c’est bien probable. Passons outre. Il faut profiter en résistant, résister en profitant. L’équipe de France de judo était bien à l’abri à Himeji, elle aussi en résistance, comme tous les athlètes présents, qui ont gardé le cap de l’entraînement, la foi en leur motivation et leurs rêves, qui ont échappé aux pièges. Un Teddy Riner souriant et plus mince que jamais vient de les y rejoindre.
Le tirage au sort vient de tomber, les Jeux vont commencer et le judo, c’est tant mieux, est installé en première semaine. Il y aura des moments de beauté qui feront venir les larmes aux yeux, des émotions qui feront la même chose, des médailles historiques, des souvenirs éternels et des images pour l’histoire, peut-être.