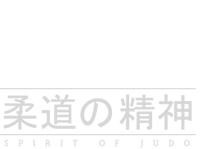Des pions sur les tapis aux coups de pinceau sur les toiles, il n’y a qu’un pas qu’il a franchi avec bonheur. International français puis entraîneur au pôle de Marseille, Hector Marino a d’abord dédié sa vie au judo. Mais l’artiste qui sommeillait en lui a fini par se réveiller et mettre en veille le sportif. Aujourd’hui, l’homme de 59 ans est un peintre reconnu, qui se nourrit aussi de son expérience dans les dojos pour donner vie à ses oeuvres.
Un enfant à part
« On peut presque dire que j’ai eu deux vies. Je suis né en 1959 à Gijon, en Espagne, de deux parents espagnols. On s’est installés à Six-Fours, près de Toulon, lorsque j’avais deux ans. J’y vis encore aujourd’hui. À l’époque, il n’y avait pas d’école maternelle et j’ai débarqué au CP sans connaître la langue. J’ai donc redoublé et, même si j’ai connu ensuite une scolarité normale, j’en ai gardé un côté introverti. Mes copains se moquaient de moi dans la cour d’école. Je me suis d’abord plongé dans la lecture et j’ai dévoré tous les Jules Verne. À 10 ans, j’ai même voulu écrire un roman. J’étais toujours enfermé dans mon univers, je passais énormément de temps à écrire – c’était presque pathologique, alors mon père m’a emmené au judo pour me faire découvrir autre chose. Au dojo, j’ai retrouvé mes copains de classe et, dès les premiers randoris, j’ai découvert que j’étais plus doué qu’eux. J’ai senti une sorte de respect de leur part. C’est comme ça que le judo est devenu ma première passion. Je ne me suis lancé dans la peinture et n’ai renoué avec l’écriture que bien plus tard. »
Le déclic de la peinture
« J’ai commencé à peindre en 2000, lorsque je dirigeais le pôle de Marseille. En feuilletant une revue, je suis tombé sur une toile de Nicolas de Staël (célèbre peintre franco-russe de l’après-guerre). J’ai passé des heures à contempler cette image : je ne voyais que des taches, mais c’était des taches sublimes, et je ne comprenais pas comment elles pouvaient me procurer une telle émotion. J’ai donc commencé à lire tous les bouquins de Nicolas de Staël, puis à peindre, mais seulement par plaisir. En 2006, je quitte le pôle de Marseille, et comme j’étais prof d’EPS, je suis retourné dans l’Éducation nationale. Mais j’ai trouvé ça très lourd et je me voyais mal attendre ma retraite avec un métier qui ne me plaisait pas. Alors j’ai fini par reprendre mes rêves : j’ai d’abord eu la chance de publier un roman (Sans aucune étoile autour, 2007), puis j’ai commencé à peindre sérieusement. J’ai rapidement pu faire mes premières expositions. Aujourd’hui, c’est devenu mon métier à part entière. On imagine souvent un artiste comme une sorte de poète détaché de la réalité, qui ne travaille que lorsqu’il a envie, quand une inspiration lui vient du ciel. Moi, je ne crois ni au talent ni à l’inspiration. Comme au judo d’ailleurs, parce que, même si on est doué, si on ne s’entraîne pas, on ne fait pas grand-chose. Travail, rigueur, abnégation : ce sont des valeurs que l’on retrouve dans les deux domaines. Même lorsque l’on fait de l’abstrait, c’est beaucoup de prises de tête. Je passe parfois des heures et des heures à contempler une toile blanche. Le premier coup sur la toile n’est jamais mis au hasard. »
Une sacrée promo
« Lorsque j’étais jeune judoka, j’ai eu quelques résultats qui m’ont conduit jusqu’à l’INSEP. Dans ma promo, il y avait Marc Alexandre (champion olympique 1988), Fabien Canu (champion du monde 1987 et 89) ou mon ami Laurent Del Colombo (quintuple champion de France). J’ai été international mais un tout petit international (3e au Tournoi de Paris 1981, NDLR). Je n’ai pas atteint le très haut niveau mais je n’en garde aucune amertume. Ça a marché pour d’autres comme Marc ou Thierry Rey (champion du monde 1979 et olympique 1980), qui ont réussi le rêve olympique qui nous motivait tous. J’ai arrêté ma carrière assez jeune, puis j’ai été pendant vingt-quatre ans responsable des garçons au pôle France de Marseille. Aujourd’hui, j’ai gardé le petit club de judo que j’avais créé à Six-Fours il y a une trentaine d’années. J’y assure la plupart des cours, et l’approche pédagogique auprès des enfants continue de me passionner. Mais j’ai cette impression palpable d’avoir tourné la page avec le judo, je suis beaucoup moins impliqué que par le passé. »
Le judoka, cet artiste
« J’ai lu une interview de Fujii (Japonais quadruple champion du monde entre 1971 et 1979), mon idole de jeunesse, dans laquelle il explique qu’un judoka est parfois plus un artiste qu’un sportif. Et c’est ce que je ressens profondément. Il faut laisser le corps s’exprimer, laisser cet enthousiasme du geste. Le travail physique et tactique doit venir après, et je crois que c’est un danger de rentrer dans un système un peu stéréotypé, comme on l’a peut-être fait à un moment dans la direction des équipes de France. C’était ma vision quand j’entraînais au pôle de Marseille mais on me répondait “non, il faut que ce soit des entraînements durs, physiques, basés sur le cardio”. Donc, évidemment, je ne pouvais pas être en osmose avec ce que l’on me demandait de faire. Comme je n’étais pas d’accord, j’ai préféré partir. »
Influences
« Côté peinture, je suis envoûté par le mythe du personnage de Nicolas de Staël. Alors, comme lui, j’ai commencé à peindre au couteau, une sorte de spatule qui permet de faire des empattements et donne un certain relief à l’huile. C’est ensuite que j’ai dévié vers des styles qui me sont plus propres. Par exemple, j’ai un style “japonais”, une sorte de retour aux sources qui vient de mon rapport très étroit avec le judo. Certaines toiles ont le côté zen du Japon. Dans d’autres, la spontanéité des projections rappelle la fulgurance du judo. Je suis aussi très lié à la mer et au petit port du Brusc, un endroit magique. Je ramasse des débris de vieux bateaux que j’incorpore dans mes toiles. Le judo a longtemps tout écrasé, et c’est pour ça que je n’ai développé cette passion que sur le tard. Dans ma jeunesse, en tant que compétiteur, j’étais focalisé sur les résultats, et il fallait aussi concilier avec les études. Lorsque j’ai ensuite basculé dans l’enseignement, c’est mon travail d’entraîneur qui prenait le pas sur tout le reste. Aujourd’hui, je peux écouter tout ce qu’il y a en moi, mais je ne renie pas pour autant mon passé de judo, au contraire. »
Propos recueillis par Gaëtan Delafolie