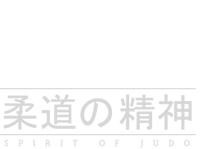Emblématique entraîneur de l’équipe cubaine, chroniqueur pour L’Esprit du Judo entre 2010 et 2012, silhouette et sourire incontournable du judo mondial des années 1990 et 2000, Ronaldo Veitia est mort quelques semaines après son rapatriement à La Havane, rapportent cette nuit des sources cubaines. En février 2016, quelques mois après qu’il ait annoncé sa retraite, nous lui avions consacré un long article sous le titre « L’éclipse d’un soleil » et un entretien XXL, à sa mesure, que vous vous proposons de relire ici.
La rédaction de L’Esprit du Judo adresse ses plus sincères pensées à son fils Ronaldo junior, à ses proches et à sa famille de cœur, celle du judo cubain.
(À nos lecteurs : article d’Anthony Diao paru en février 2016, L’Esprit du Judo N°60)
« Un homme comme vous naît une fois tous les cent ans » lui écrivait début décembre dans un e-mail collectif émouvant son adjoint Ismael Borboña, époux à la ville de la -56 kg Cécilia Alacán, première médaillée planétaire du judo féminin cubain en 1988 aux mondiaux universitaires de Tbilissi. « Il m’en aura donné, des nuits blanches ! » appuie la coach brésilienne Rosicleia Campos, qui admet volontiers sa « fixette » cubaine à l’échelon panaméricain depuis sa prise de fonction en 2005. « Il est le meilleur entraîneur du monde et pourtant il n’aime rien tant que bouquiner, écrire et cultiver les orchidées de son jardin. Il est mon père, mon exemple et ma fierté », souligne depuis le Pays basque espagnol où il enseigne, son fils Ihosvany, aîné des cinq enfants – et dix petits enfants – que « El Veiti » aura essaimé sous diverses latitudes avec trois compagnes différentes.
Cœur. « J’ai rencontré l’équipe cubaine de Ronaldo en 1991 à Barcelone lors de mes premiers championnats du monde, rembobine l’Italienne Emanuela Pierantozzi. J’ai gagné et son élève Odalis Revé a pris le bronze. Nous ne nous sommes pas rencontrées ce jour-là – elle me battra un an plus tard en finale des Jeux – mais j’ai compris deux choses : un, elle était très forte et deux, son entraîneur était encore plus fort qu’elle. Pour moi il est vite apparu évident que Ronaldo était l’âme et le cœur de cette équipe. » Doté de l’œil du maquignon et d’une capacité inouïe à insuffler un mental de Viet-Cong à ses athlètes (sur le séant desquelles il laissait « encore un peu trop traîner sa main à cette époque » glissera une observatrice), « El Profe » aurait sans doute explosé son plafond de 57 médailles mondiales s’il n’avait pas fallu attendre 2009 pour voir instaurée l’annualisation des championnats du monde.
Standing. Les fidèles lecteurs de l’EDJ sont familiers du parcours et des analyses tranchées de celui qui fut notre chroniqueur entre 2010 et 2012. De ses débuts en 1963 dans sa ville natale de Cotorro contre l’avis de son père et avec la complicité (déjà) de sa mère, à ses expériences professionnelles alimentaires récemment rappelées par notre confrère Joel García du journal Trabajadores (serveur, emballeur de coton, ouvrier dans une fabrique de papier…), les premiers pas du jeune homme furent de grands pas pour son humanité. Retraité des tapis à 25 ans après quelques accessits internationaux en -93 kg dans des tournois de l’ancien bloc communiste, sa vocation d’enseignant et de leader maximal ira crescendo en parallèle de l’émergence du judo féminin sur l’île. « Le premier championnat national féminin officiel eut lieu en 1981 et réunit 120 filles venues des 15 provinces », resitue la moustache de Justo Noda, son alter ego jusqu’en 1995 avant de s’en aller reprendre les rênes d’une équipe masculine en crise. « Il faudra attendre le 20 mars 1983 et l’approche des Jeux panaméricains de Caracas cette année-là pour que soit créée l’équipe nationale féminine cubaine entrainée par Vicente Leal Duarte et Gago Fondin », poursuit l’entraîneur d’Asley González et de José Armenteros. C’est sur ce terreau, rendu frémissant par la perspective de l’introduction prochaine du judo féminin aux JO, que débarqua en 1986 un certain Hilarión Ronaldo Veitía Valdivié, fraichement rentré de douze mois comme entraîneur de la sélection féminine du Mexique.
Intensité. Ce qui fit la force du judo féminin cubain de cette époque explique aussi ses limites actuelles. Telle est la thèse d’Israel Hernández, 3e en -65 kg aux JO 1992 et 1996, aujourd’hui citoyen américain et coach en Californie. « Au début, l’équipe nationale s’appuyait sur des athlètes déjà solidement armées techniquement grâce à la formation reçue dans leur province d’origine… » Ronaldo et ses adjoints pouvaient alors ajouter leur patte, novatrice à l’époque, à savoir une préparation physique et tactique d’une intensité et d’une rigueur inédites pour des femmes, une planification scientifique des pics de forme et une flamme patriotique savamment entretenue à coups de proverbes et de dictons (son péché mignon). « Je me souviens de tours de stade en brouette à mains nues sur le tartan, que nous avions effectués les paumes intégralement strappées alors que les Cubaines, non » en rit encore la médaillée olympique Stéphanie Possamaï, tandis que l’Espagnole Cecilia Blanco fut la témoin indirecte de « sessions de tractions à trois chiffres » de l’icône Driulis González. « J’ai été en 1994 la première championne du monde juniors de l’histoire du judo US, enchaîne l’Américaine Hillary Wolf-Saba. Mais l’un de mes plus beaux souvenirs restera sans doute ma victoire en 1997 au tournoi A d’Autriche, du simple fait que j’y ai battu, pour la seule et unique fois de ma carrière, la Cubaine Savón ». Même le staff japonais n’eut d’autre choix que de s’intéresser de près au phénomène. « Oui, Ronaldo a influencé notre judo, reconnaît l’ancienne -52kg Noriko Mizoguchi. Ses filles nous ont poussées à travailler davantage le kumikata, mais aussi des techniques comme morote-gari, kuchiki-daoshi ou sode-tsuri-komi-goshi… » Bref, quelle que soit la catégorie, « prendre une Cubaine à cette époque, c’était LE défi physique et mental » résume Cathy Fleury. La championne olympique 1992 fut de cette génération d’équipes étrangères pour qui les enceintes suintantes des dojos de La Havane, Holguín ou Cienfuegos furent un passage annuel obligé. Et elle dut attendre de devenir entraîneur au pôle d’Amiens pour rompre enfin la glace avec des filles longtemps crues « distantes et fières », barrière de la langue oblige, et instaurer avec son mari Patrice Rognon de mémorables échanges à la façon d’autres clubs français depuis.
Méthode. Intronisée l’été dernier au Hall of Fame de la Fédération internationale, l’actuelle entraîneure nationale Driulis González est l’incarnation du stakhanovisme conquérant des années Ronaldo. Quadruple médaillée olympique – dont un titre à Atlanta, septuple médaillée mondiale (dont trois titres), elle remporta par exemple les 76 combats qu’elle disputa en 1999, puis 66 des 68 combats de l’année suivante, prit un congé maternité comme plusieurs de ses coéquipières avant et après elle, et revint dans la catégorie supérieure des -63 kg pour « montrer à [son] fils Javier ce que c’est que gagner ». Une seconde partie de carrière moins conflictuelle que la première puisque, à en croire l’Espagnole Yolanda Soler, 3e des JO 1996 en -48 kg, qui bastonna souvent avec le groupe lors de leurs nombreux passages au club de Miriam Blasco à Alicante, « si Ronaldo savait tirer le meilleur de chacune, toutes n’étaient pas toujours en phase avec ses méthodes ». Marche ou crève ? Il y avait de ça, et un peu plus encore, à entendre Javier Alonso, professeur de l’autre club d’Alicante et mari à la ville d’Isabel Fernández, l’éternelle rivale de Driulis González. « Observer Ronaldo diriger ses séances fut pour nous une leçon : il est possible de compenser le déficit technique, lié à l’isolement insulaire qui était le leur, par une préparation physique de choc et une analyse fine de la tactique et de l’arbitrage. » Une leçon bien retenue aussi par la soliste colombienne Yuri Alvear, championne du monde 2009, 2013 et 2014, marquée par son unique passage sur l’île dans le dojo-bis de Kid Chocolate, en 2008 : « J’ai compris là-bas qu’il était possible de gagner avec peu. Le plus important est l’envie, l’attitude et l’intensité de la pratique. »
Déclin. Voici plusieurs années pourtant que la machine de guerre connaît quelques ratés. Les variations de poids du Sensei ? Les mouvements au sein du staff ? L’ouverture à l’Ouest ? Pour Israel Hernandez, donc, le boa s’est plutôt lui-même mordu la queue. « Devant les succès de l’équipe première, les entraîneurs des provinces ont décidé de s’en inspirer et ont délaissé leur mission fondamentale de transmission de bases techniques solides, au profit d’une préparation physique plus poussée mais aussi à plus courte vue. Le résultat est une génération moins armée techniquement, et cela se voit. Et malheureusement tout est lié : combien d’expérimentés entraîneurs de provinces n’ont eu d’autres choix que de quitter Cuba pour espérer de meilleurs lendemains ? Ces départs laissent un vide technique qui ne se comble pas en quelques années. Idem pour les anciennes championnes : une fois à la retraite, la plupart quittent le tatami pour aller gagner leur vie ailleurs. Avec elles, ce sont de précieuses années d’expérience qui s’en vont… » Pour Cathy Fleury, les causes seraient également externes. « Le système onéreux de la ranking les a sévèrement impactés, de même que les changements de règles puisqu’elles attaquaient beaucoup aux jambes ou en reprise… ».
Testament. De quoi sera fait l’an II du judo féminin cubain ? Ses successeurs auront-ils les épaules ? En partant brutalement à neuf mois des Jeux, trois mois après une campagne d’Astana offrant – Idalys Ortiz exceptée – l’image inhabituelle d’une équipe presque démobilisée par le vide à venir que le spectre de sa retraite annonçait déjà, l’entraîneur aux mille coups de poker – cf. les inattendues médailles d’argent d’Anaisis Hernandez et Yalennis Castillo à Pékin, toutes deux décalées d’une catégorie un mois avant les Jeux suite à la défection soudaine de Yurisel Laborde – n’a-t-il pas tenté là le sacrifice ultime d’un électrochoc collectif en guise de testament ? Nous lui avons posé cette question au milieu de toutes celles qui suivent. Il a éludé d’un sourire malicieux, préférant « disséquer l’œuvre plutôt qu’insulter l’avenir ». « Avec son départ, c’est un peu de ma jeunesse qui s’en va, conclut l’Italienne Pierantozzi. Mais je veux retenir une chose : malgré les innombrables heures d’entraînement aux côtés de son équipe, je n’ai jamais vu une seule fois Ronaldo démontrer une technique, un uchikomi ou une esquive. Jamais ! Je pense que ceux qui ne jurent que par la technique devraient méditer là-dessus… » Sacré tour de force. Sacré Ronaldo.
Ronaldo, l’interview
Le 17 novembre dernier (2015, NDLR), vous annonciez en exclusivité sur le site de L’Esprit du judo votre retraite « anticipée » au soir du Grand Chelem de Tokyo, trois semaines plus tard. Comment s’est déroulée cette fameuse journée du 6 décembre 2015 ?
Je me suis levé en me disant que c’était une journée comme les autres. La seule différence c’est que je n’avais pas la sensation d’aller travailler. Je savais que cette fois je me dirigeais vers un avenir qui n’était désormais plus celui de mes athlètes, seulement le mien et celui des miens. Je vais sur mes 70 ans et il est important pour moi de me retirer suffisamment en forme pour pouvoir savourer l’œuvre accomplie.
Il y a eu de l’émotion ?
Beaucoup. Surtout, ces dernières heures furent placées sous le signe du privilège et de l’honneur. J’ai eu le privilège d’être rejoint la veille par mon épouse Mercedes qui, même à distance, aura tout vécu à mes côtés jusqu’à cette journée spéciale. Et j’ai eu l’honneur de devenir le premier entraîneur non japonais à avoir droit à une cérémonie solennelle sur la terre-mère du judo.
Le judo mondial, représenté par Marius Vizer et Jean-Luc Rougé, vous a rendu hommage. Cela vous a touché ?
Oui, c’est réconfortant après toutes ces années de combat… Vraiment, j’ai été gâté sur cette journée puisque même le grand Yamashita est venu me remettre un présent. Ce sont des marques d’attention qui ne s’oublient pas. Jamais je ne remercierai assez le judo pour tout ce qu’il m’a apporté.
Pour votre ultime combat sur la chaise, Idalys Ortiz s’incline en finale des +78 kg contre la Japonaise Inamori, non sans l’avoir maintenue neuf secondes en osae-komi. Que vous êtes-vous dit à sa sortie du tapis ?
Sur l’instant, rien. S’il en était ainsi, c’est qu’il devait en être ainsi. En revanche, après sa demi-finale victorieuse – où elle était sincèrement désolée d’avoir blessé la Française Erb -, je lui ai dit que sa performance me touchait parce que c’était elle, parce que c’était là, parce que c’était ce jour-là. Je savais qu’elle avait une fois encore répondu présent non pas pour elle mais pour son peuple. Elle m’a alors répondu : « Profe, ne me faites pas pleurer ! » Je lui ai dit : « Surtout ne pleure pas parce qu’à chaque fois que tu pleures, tu laisses en influx ce que tu as gagné jusque-là ! » Elle m’a alors dit que quel que soit le métal, elle me dédierait cette médaille… Lorsqu’elle s’est avancée pour la finale, je lui ai seulement dit « Sois intelligente ». Le reste était écrit.
Elle est le pilier de votre équipe depuis une olympiade. Votre décision a dû être rude à encaisser pour elle…
Elle m’a mis le doute au point que j’en ai presque eu des remords. Mais je suis un homme de parole et ce qui est décidé est décidé, point. Nous en avons longuement parlé. Idalys l’a compris et l’a accepté. Je n’en attendais pas moins d’une championne de sa trempe.
De retour à Cuba, êtes-vous allé saluer le reste de l’équipe qui n’était pas de la tournée asiatique ? [Soucieux d’éviter le tumulte que son annonce surprise ne manquerait pas de provoquer dans son pays, Ronaldo Veitía avait souhaité que l’article du site de l’EDJ ne soit publié qu’après s’être envolé pour l’Asie, NDLR]
Les adieux sont des moments tristes. Ma priorité à mon retour a été de partager ce moment avec mes voisins, mes amis, les enfants de mon dojo. Tous ont été heureux de ces quelques heures passées ensemble. Je me suis ensuite rendu avec mon fils René au centre d’entraînement du Cerro Pelado, mais c’était essentiellement pour récupérer des papiers pour mon dossier de retraite… Il y a eu une cérémonie avec Idalys le 23 décembre, une autre est prévue en janvier en marge du Grand Prix de Cuba. Pour le reste, nous nous verrons plus loin sur le chemin. C’est mieux ainsi.
Quelles ont été les réactions à Cuba ?
Je sais que certaines athlètes ont été ébranlées par cette décision. Il y a eu des larmes, du déni. J’entends cela comme j’entends les « Plus rien ne sera jamais pareil ». Rien n’est jamais pareil, effectivement, mais surtout nul n’est éternel et certainement pas moi [Sourire]. Comme le dit un chanteur, « l’important n’est pas d’imposer sa présence mais de faire ressentir son absence ». Quelque part c’est flatteur pour ma personne de susciter ces réactions. Je ne peux pas faire un pas dans la rue sans que quelqu’un ne s’arrête pour me saluer. Maintenant, s’il y a une chose avec laquelle je suis au clair, c’est que j’ai donné trente années de ma vie à mon pays. Et je sais que cela, le peuple cubain ne l’oubliera pas.
Sur les réseaux sociaux, vous avez réservé un paragraphe cinglant à vos détracteurs. À qui faisiez-vous allusion ?
À des gens qui ne méritent pas d’être nommés. Tu sais, il y aura toujours des personnes pour se placer entre toi et le bien que tes actes semblent mériter. La vie est ainsi faite. J’ai toujours veillé à dire la vérité, et cela m’a valu des inimités. Et alors ? Je suis gros mais je suis transparent. Pour moi, la jalousie, c’est admirer avec de la colère. Les jaloux veulent être comme ceux qu’ils jalousent mais ne le peuvent pas, alors ils se rabattent sur ce triste sentiment. J’ai une philosophie de vie face à ça : lorsque tu entends des ragots, envole-toi loin au-dessus. Lorsque ces ragots persistent, vole encore plus haut car les rats sont sujets au vertige et, quoi qu’il arrive, tes résultats leur fermeront la bouche.
Elles se reconnaîtront…
Comme je le dis souvent, « la vie n’est pas faite pour être comprise mais pour être vécue. C’est en la vivant que tu la comprendras, même s’il peut tout aussi bien arriver que tu meures sans l’avoir comprise. » Au final qu’importent ces mauvaises langues, tant qu’il existe des gens de bien pour te transmettre leurs bonnes vibrations. C’est plutôt de ces personnes-là que je veux être entouré aujourd’hui. Et c’est pour elles que j’étudie à présent. Je veux devenir Docteur dans ma spécialité, le judo, car être en retraite ne veut surtout pas dire être en retrait ! [Sourire]
Revenons sur ces trois décennies. En nous aidant à préparer cet entretien, de nombreux observateurs cubains et étrangers se sont accordés sur un point : le judo féminin cubain a connu un âge d’or entre les JO de 1992 et ceux de 2004, et connaît depuis un relatif déclin. Partagez-vous cette analyse ?
C’est assez juste même si chaque résultat doit être replacé dans son contexte. Entre 1986 et 1992, je dirais que nous découvrions tout cela. D’abord, il nous a fallu nous convaincre nous-mêmes que nous pouvions faire partie de l’élite mondiale. Passer du statut de spectateur à celui d’acteur, c’est avant tout une question de foi en soi. Et cette foi se construit au fil des épreuves et des défis, des victoires mais aussi des remises en question. En ce sens, le titre mondial d’Estela Rodríguez en 1989 à Belgrade puis notre première place aux championnats du monde juniors de Dijon en 1990 ont constitué deux paliers importants dans cette prise de conscience et de confiance en nos capacités. Deux ans plus tard, l’or d’Odalis Revé et notre troisième place au classement des nations lors des Jeux de Barcelone ont confirmé cet élan. C’était la génération dorée des Amarilis Savón, Legna Verdecia, Driulis González…
… bientôt rejointe par celle des Daima Beltrán et autres Diadenis Luna, avec qui elles réaliseront le fameux grand chelem aux huit médailles d’or individuelles lors des Jeux panaméricains de Mar del Plata en mars 1995…
… l’année-même où nous deviendrons première nation lors des Mondiaux de Chiba. Quels souvenirs extraordinaires ! Qui peut aujourd’hui imaginer la fierté qui fut la nôtre cette année-là ? Nous, petite île des Caraïbes, en train de danser dans la chambre-même du berceau du judo ? J’ai toujours dit que, être cubain, pour moi, ce n’est pas une obligation mais une bénédiction. Je crois que seule notre première place au classement des nations cinq ans plus tard lors des Jeux de Sydney a pu égaler ce bonheur-là.
C’est à Sydney d’ailleurs que votre joie trop démonstrative a été douchée par les officiels…
Ah, ce moment… [Sourire] Je m’en souviens comme si c’était hier. Legna [Verdecia, NDLR] met ippon à la Japonaise en finale. De joie, j’attrape un drapeau cubain et commence à l’agiter en l’air. C’est alors qu’un officiel français essaye de m’arracher le drapeau. Sauf que j’ai donné ma vie pour ce jour-là alors personne ne m’empêchera de brandir le drapeau de mon pays ! Je l’ai donc repoussé, et ce geste m’a valu d’être privé de chaise le lendemain… Bon, cela ne m’a pas empêché de coacher à pleins poumons depuis les tribunes ni Driulis d’atteindre sa seconde finale olympique d’affilée, hein [Rires].
Comment expliquez-vous le déclin progressif qui a suivi cet âge d’or ?
Dans le sport d’élite, le plus difficile n’est pas d’arriver au sommet mais de s’y maintenir. Nous avons réussi cette prouesse pendant près de quatre olympiades, en panachant des athlètes d’expérience avec des nouvelles têtes. Notre première place aux Mondiaux du Caire en 2005, avec le titre notamment de notre junior Yanet Bermoy, en fut une fois encore l’illustration. Maintenant – et c’est quelque chose que j’ai souvent répété dans mes chroniques dans votre magazine [cf. EDJ26 à EDJ40] – notre réalité économique est à des années-lumière de celle de pays comme le Japon ou la France. Nous sommes un pays communiste. En 1989, l’URSS, notre alliée historique, a été dissoute. Six mois plus tard, notre gouvernement a proclamé notre entrée dans la « Période spéciale en temps de paix ». Cette ère de restrictions draconiennes dure depuis lors. Elle ne nous a pas empêchés de remporter sept fois d’affilée les Jeux panaméricains, de 1991 à 2015. Car il faut bien comprendre une chose : quand vous affrontez une Cubaine, ce n’est pas un individu qui se dresse face à vous mais la somme des fiertés et des attentes d’un peuple. Mille fois nous avons failli rester sur le côté, mille fois nous avons triomphé. Cela, nul ne pourra jamais nous l’enlever.
Est-il vrai que vos athlètes, lorsqu’elles ne sont pas en tournoi, ne sont pas au courant des résultats sur le circuit ?
C’est l’un des chantiers en cours car nous sommes une île qui a longtemps été privée de tout. À Cuba, seuls de rares athlètes vedettes et quelques entraîneurs confirmés ont aujourd’hui le Wi-Fi. Grâce à Dieu, je fais partie de ces privilégiés !
Plusieurs exils ont également émaillé ces années. Il y a eu celui d’athlètes au sommet – la double championne du monde Yurisel Laborde en 2008 [cf. EDJ15], son homonyme María-Celia en 2014, la -48 Danieska Carrión avant Athènes… – mais aussi celui, moins médiatisé, de nombreux entraîneurs de province. La perte technique et d’expérience que ces départs constituent est-elle aussi l’une des raisons de ce déclin ?
C’est indéniable. Si la base s’appauvrit, le sommet s’appauvrit mécaniquement. Tu sais, Cuba fourmille d’entraîneurs potentiellement compétents mais, encore une fois, le contexte économique ne permet pas de créer des opportunités pour bonifier leur apport. C’est un enjeu quotidien.
Avez-vous des nouvelles de vos athlètes exilées ? Leur en voulez-vous ?
Elles me donnent des signes de vie par les réseaux sociaux et j’accepte leur salut car les choses de la vie sont ainsi. Je sais qu’elles ont toujours du respect pour moi. Pour le reste, elles ont fait leur choix.
Et vous, avez-vous été sollicité pour exporter vos connaissances et entrainer une équipe étrangère ?
C’est arrivé, oui. Mais, quelles que soient nos difficultés, je suis trop attaché à mon pays et à son histoire pour ne serait-ce qu’étudier cette éventualité. [Sourire]
Avez-vous vous-même été parfois tenté de faire appel à des techniciens étrangers ?
Jamais, et cela aussi participe de notre fierté à l’heure du bilan. Notre réussite est 100 % cubaine. La clé tient en quelques mots : la disponibilité et le désir absolu de vouloir devenir celui que tes capacités te permettent d’espérer être.
Vous mettez souvent en avant l’importance de votre « collectif technique ». Qu’entendez-vous par ce terme ?
Il s’agit justement de ce noyau de personnes dédiées corps et âme à leur travail et investies quotidiennement dans la quête du succès. Cette ambition commune est le ciment de l’équipe. Longtemps j’en ai été le cœur, aujourd’hui je passe la main.
Armando Padrón, votre successeur, a longtemps été votre adjoint après une expérience avec l’équipe du Venezuela. Quels rapports conservez-vous avec cette nouvelle équipe ?
C’est une question délicate. Je me la suis évidemment posée au moment de prendre cette décision. Il est important pour moi de trouver la juste distance. Ne pas m’immiscer, laisser à mes successeurs le temps de prendre leurs marques et se frotter à leurs nouvelles responsabilités. Il y a un héritage mais aussi une continuité à inventer. Nous avons tracé un sillon et j’espère qu’il en restera quelque chose. Et si tel n’est pas le cas, la vie leur renverra l’addition ! [Sourire]
Vous donnerez des conseils, même de loin ?
Même pas. Tu sais, quand je quitte une femme, je ne m’occupe pas de savoir qui lui mettra la main aux fesses ensuite (sic). Je ne suis pas homme à donner des conseils si l’on ne m’en demande pas. Ce poste a longtemps été le mien, mais il ne m’appartient pas. Il faut savoir partir sans conserver le double des clés [Sourire]. La seule chose qui m’importe, c’est le bien du judo féminin cubain.
Vos successeurs ont-ils droit à l’erreur ?
Les résultats seront leur juge de paix. Depuis 1987, il y a toujours eu au moins une judokate récompensée fin décembre lors de la cérémonie en l’honneur des dix meilleurs sportifs cubains de l’année. Nous sommes le seul sport à afficher cette constance à Cuba. Comme je dis souvent, il ne faut jamais oublier ce qui a été accompli, car cela expose à un futur plus précaire. Nos méthodes ont semble-t-il fait leurs preuves sur la durée. S’en inspireront-ils ? Rompront-ils pour expérimenter une nouvelle approche ? Le temps le dira.
Il arrive qu’un héritage se dilapide rapidement…
C’est le risque. Changer pour changer, c’est toujours à double tranchant. L’histoire nous enseigne que souvent, lorsque des personnes arrivent au pouvoir, elles sont pressées de briller ou de démontrer je-ne-sais-trop-quoi, et font pour cela table rase de ce qui fonctionnait jusqu’à leur arrivée, sans en mesurer pleinement les conséquences. Encore une fois, c’est sur la durée que se vérifiera la pertinence des caps et des choix.
Quelles ont été vos sources d’inspiration au fil des années ?
Le judo français a toujours été une source d’inspiration pour moi. Quand je vois, malgré son palmarès, la modestie et la simplicité d’un Teddy Riner lorsqu’il s’adresse à moi ou à Idalys par exemple, je me dis qu’il y a à apprendre de ça. Côté Cubains, outre les héros de la Révolution qui restent des exemples au quotidien, j’ai beaucoup appris d’entraîneurs comme le regretté Eugenio George Lafita, qui fut trois fois champion olympique de volleyball avec son équipe féminine, ou Alcides Sagarra, qui détient le record de médailles internationales en boxe. Nos succès respectifs s’appuient sur les mêmes piliers : des sacrifices, de la sueur, des larmes et une identité très marquée.
Votre équipe a souvent préparé les grandes échéances loin de Cuba. Pour quelles raisons ?
Effectivement nous sommes souvent venus nous préparer en France et en Espagne. Ce fut une aide précieuse pour nous que de nous échapper quelques semaines des difficultés posées chez nous par la Période spéciale que j’évoquais précédemment. Nous avons ainsi rencontré des personnes formidables d’humanité et de solidarité. Comme de notre côté nous ne transigions pas avec les efforts demandés à nos athlètes, tant à l’entraînement qu’en termes de disponibilité lors des cérémonies organisées par nos hôtes, cela a certainement contribué à favoriser cette émulation. Je crois que cela rejoint l’un des principes fondateurs du judo, qui est celui de l’entraide et de la prospérité mutuelle. Jamais nous n’oublierons l’accueil que ces clubs nous ont réservé, sans jamais nous demander un centime.
Vous entretenez d’ailleurs une relation privilégiée avec certains clubs français. Comment tout cela a-t-il commencé ?
C’est une belle histoire. Un jour, en Bulgarie, j’ai rencontré Paulette Fouillet. Elle était à cette époque entraîneur principale de l’équipe de France féminine. J’ai toujours admiré le judo français alors je lui ai demandé comment nous pourrions nous coordonner pour que mes athlètes puissent un jour fouler le tatami du prestigieux Tournoi de Paris. Un an plus tard, nous étions invités à Coubertin. Là, j’ai expliqué à la Fédération française que nous n’avions pas d’argent mais que nous aimerions malgré tout participer au stage international qui suivait le tournoi. Le refus a été catégorique. C’est alors que Gérard de la Taille, un professeur de Toulouse, nous a invités à venir dans son club. Tous frais payés, par amitié et sympathie pour notre équipe.
Cela s’est ensuite pérennisé…
Oui car l’année suivante, rebelote. Nous avons combattu au Tournoi de Paris et avons cette fois été autorisés à prendre part au stage international. Mais je ne pouvais pas oublier celui qui nous avait tendu la main lorsque nous étions dans la difficulté, alors j’ai décliné l’invitation et nous sommes retournés à Toulouse.
Ce soutien à une nation concurrente a parfois été reproché à vos hôtes…
Oui. Mon ami Gérard de La Taille était déjà 6e dan depuis plusieurs années lors de notre première rencontre il y a bientôt 25 ans, et je suis étonné de voir qu’il n’a toujours pas obtenu son 7e dan depuis. Je sais que la famille Deutzer de Pont-à-Mousson, qui nous accueille également depuis plusieurs années, a également subi des remarques en ce sens. C’est malheureux, vraiment, et je suis là pour témoigner que si des personnes méritent d’être valorisées pour leur mise en pratique concrète des valeurs du judo, ce sont précisément ces personnes-là.
À l’heure du dégel diplomatique, quelles relations avez-vous avec les Etats-Unis ?
La Fédération américaine a toujours été super avec nous. Ils nous ont souvent invités sur des tournois – à New York par exemple – et nos relations sont excellentes, simples et franches. Et peut-être que vous ne le savez pas parce qu’elle est trop modeste pour s’en vanter mais, lorsqu’elle a remporté le Grand Prix de La Havane en juin 2014, Kayla Harrison a tenu à offrir l’intégralité de sa prime de victoire à la fille d’une de mes athlètes. Ce geste n’a fait que grandir mon respect pour cette athlète, qui remonte à plusieurs années. Ses qualités athlétiques se doublent d’une belle âme. C’est exactement le profil de personnes dont je souhaiterai exclusivement m’entourer à cette étape de ma vie.
À ce propos, selon certaines de vos anciennes athlètes, vous vous seriez adouci avec les années…
Il est certain qu’avec le temps vous devenez davantage un père qu’un entraîneur. Ai-je baissé mon niveau d’exigence pour autant ? Je ne le crois pas. Pour moi la discipline reste une vertu cardinale. Lorsque vous êtes confrontés à des problèmes économiques tels que les nôtres, les raisons de baisser les bras sont quotidiennes. L’athlète arrive avec son éducation, moi avec ma discipline et mon expérience, et ensemble nous allons chercher les résultats. Alors oui il y a parfois eu des cris et des larmes car l’exigence n’est jamais très loin de la dureté, mais qu’importe à l’arrivée puisqu’une fois les carrières achevées, qu’est-ce que je constate ? Qu’il demeure entre nous de la reconnaissance et un respect mutuel, le souvenir d’avoir été sincères avec l’autre et avec soi-même.
Si le Ronaldo de 2016 croisait le Ronaldo de 1986, que lui dirait-il ?
Je l’encouragerais à travailler avec le même enthousiasme. C’est à cette condition qu’il pourra relever les multiples défis auxquels j’ai moi-même été confronté et, qui sait, marquer son époque par les résultats de son équipe. Je lui dirais d’aimer ce qu’il fait et de ne jamais rien regretter. Je l’inciterais à être plus vigilant que je ne l’ai été à l’égard de personnes qui ont un jour trahi ma confiance. Le poids des responsabilités ne doit pas faire oublier l’esprit de loyauté.
Avez-vous des regrets ?
Aucun. Celui qui veut avancer doit regarder devant lui. Le passé aide à comprendre le présent mais le futur, si possible meilleur, doit rester notre unique horizon… Si je n’ai pas de regrets, j’ai en revanche des souvenirs d’injustice. Je pense à la finale de Driulis à Sydney – celle que j’ai dû suivre des tribunes… -, à la place de trois de la même Driulis à Pékin, à la finale de Yalennis Castillo sur ces mêmes Jeux… Je n’ai pas de regrets mais il n’y a pas de douleur plus grande que le sentiment de perdre injustement un combat. Si le temps n’a pas atténué ces peines, c’est que les blessures étaient non seulement profondes mais surtout réelles.
Un dernier mot ?
Merci à votre magazine de m’avoir consacré ce temps d’échange et de transmission et que Dieu bénisse les gens de bien. Je m’en retourne auprès de ma famille parce que c’est le plus important de la vie. J’arrive à ce moment de l’existence où tu accordes enfin aux choses, aux êtres et aux moments l’importance qu’ils méritent. Le comprendre est parfois un long chemin. Le vivre est fabuleux. C’est mon unique souhait à présent… Longue vie au judo féminin cubain !