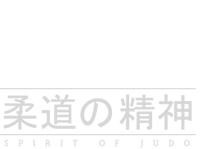Depuis 2018, Natsume Miwako Le Bihan a rejoint Jocelyne Triadou et la regrettée Paulette Fouillet dans le cercle des premières femmes du judo français à porter le huitième dan. Retour sur soixante-treize années d’une existence tendue vers la maîtrise des katas et la connaissance de soi.
ALLER SIMPLE
J’ai débuté le judo à l’âge de quatorze ans au Kodokan de Tokyo. Je n’ai jamais fait de compétition car, à l’époque, le judo féminin restait une exception. Les professeurs étaient tous des hommes et les garçons ne se mélangeaient pas avec nous. Grâce à mes six entraînements hebdomadaires, j’ai obtenu mon premier dan à dix-sept ans, puis suis devenue professeur d’éducation physique. Peu après, j’ai eu l’opportunité de collaborer à un livre consacré aux katas. C’était à l’initiative de Claude Urvoy, un professeur de Brest qui avait effectué plusieurs séjours au Japon. Il m’a invité à passer un an en France et j’ai dit oui. Nous étions à l’été 1970 et j’avais vingt-trois ans. À mes côtés pour ce livre et ce voyage, il y avait Odile Martin, qui était mon aînée d’un an et mon élève au Budokan. Elle était journaliste au Télégramme de Brest, écrivait dans le magazine fédéral et épousa plus tard un Japonais. Ensemble, nous avons décidé de rejoindre Brest par… la route. La firme Mazda nous a prêté une voiture et l’objectif était d’arriver à Paris le 1er octobre, date de l’ouverture du Salon de l’automobile. Nous avons ainsi parcouru vingt-six mille kilomètres et traversé seize pays. Le voyage a duré trois mois et trois semaines, en bateau jusqu’en Inde puis sur les pistes. Mazda ayant des antennes dans tous les pays que nous avons traversés, nous faisions contrôler la voiture dans la capi- tale des pays en question, du Pakistan à la Yougoslavie en passant par l’Afghanistan, le Népal ou l’Iran. Beaucoup d’aventures et d’émotions, mais nous sommes arrivées toutes les deux à bon port et à temps.
CET AUTRE FINISTÈRE
J’ai laissé au Japon mes parents et une sœur puisque mon année en France est devenue ma vie… C’est à Brest que j’ai rencontré mon mari Jean-Claude, sixième dan. Nous nous sommes mariés en 1973 et notre fille Caroline enseigne le judo et s’illustre à présent sur le circuit vétérans. Nous avons travaillé avec Monsieur Urvoy jusqu’en 1994, date à laquelle nous avons ouvert notre club du Shudokan. L’idée était que je m’occupe des débutants, des loisirs, du jujitsu et des enfants, tandis que mon mari s’occupait des compétiteurs. J’adore la mentalité de Brest car les gens ont la tête dure, il y a beaucoup de points communs avec les Japonais. La seule chose qui me pose problème, c’est ce climat si particulier, même si la chaleur des personnes remplace bien des soleils. Ce qui est certain, c’est que si j’avais vécu à Paris peut-être que je me serais déjà rapatriée… (sourire)
LA BEAUTÉ DU GESTE
J’étais déjà en France lorsqu’en 1975 les compétitions féminines ont à leur tour commencé au Japon. C’est la raison pour laquelle je m’étais spécialisée dans l’étude et la transmission des katas, que j’ai enseignés en Angleterre, en Suisse, en Belgique, au Canada et surtout un peu partout en France. Enseigner les katas, c’est se souvenir que le judo n’est pas que la compétition. En France, il est possible de faire les deux et il faut qu’il y ait les deux. À partir du cinquième dan, je suis toujours allée passer mes grades au Kodokan car je n’ai jamais oublié l’école qui m’a formée. Là-bas, il y a toujours une section féminine protégée, où nous pouvons nous entraîner sans nous inquiéter de la blessure… Je n’ai jamais oublié non plus la contrariété de Miyake Tsunako, celle qui m’a appris le judo, lorsque je lui ai annoncé mon départ pour la France. Elle voulait que je prenne sa suite mais c’était un milieu fermé. Aujourd’hui, elle a quatre-vingt-douze ans, elle est en maison de retraite, mais je n’oublie pas ce que je lui dois, en judo comme dans la vie. J’ai eu la chance d’avoir Jacques Le Berre pour parrain en France mais j’ai aussi beaucoup pensé à Mme Tsunako en décembre 2017 au Kodokan lors de la remise de mon huitième dan, lorsque Monsieur Uemura m’a remercié d’avoir « transmis le judo dans beaucoup de pays ». Ce sont des mots simples mais qui signifient beau- coup pour moi.
QUARTIERS LOINTAINS
En France, un couple de professeurs, ça fonctionne. Au Japon, quand le couple fait le même métier, ça marche moins car les gens ne veulent pas parler travail à la maison. Pour nous, le judo, c’est la vie. J’y suis tous les jours : du lundi au samedi, j’enseigne, et, le dimanche, je suis en déplacement. À Brest, il y a aujourd’hui une communauté japo- naise. La ville est jumelée avec Yokosuka depuis 1997 et j’ai assuré la présidence de ce jumelage jusqu’en 2018. Cela fut l’occasion de participer à des échanges de lycéens, et donc de m’y rendre régulièrement pour voir ma famille. C’est important notamment pour ma fille qui a dû at- tendre ses dix ans pour pouvoir y aller pour la première fois – elle a d’ailleurs pris japonais en deuxième langue à la fac… Pour autant, rentrer chez moi, aujourd’hui, ça veut dire rentrer en France car, en cumulé, c’est là que j’ai le plus vécu. Mon accent ? Parfois, des enfants me demandent pourquoi je n’ai pas le même qu’eux. Cela arrive en stage et c’est très bien qu’ils expriment cela…
LES CHOSES DE LA VIE
Les enfants japonais écoutent et appliquent les consignes sans poser de questions. Les enfants français, eux, écoutent moins religieusement mais osent davantage lever la main, parfois dans tous les sens, et c’est alors à l’enseignant de recadrer les échanges. J’ai commencé à enseigner en France à l’âge de vingt-trois ans, donc j’ai pu intégrer ces différences culturelles assez vite. C’est moins le cas pour des compatriotes qui arriveraient en France avec quelques années de plus. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’au Japon, le judo est perçu comme un complément à l’éducation reçue à la mai- son et à l’école. Pour les élèves français, en revanche, le judo se substitue parfois à l’un ou/et à l’autre de ces deux piliers éducatifs. C’est pour cela que, s’il était possible il y a encore quelques années de dis- penser un enseignement de qualité à des groupes pouvant compter jusqu’à une quarantaine d’enfants, aujourd’hui la moitié suffit large- ment. Limiter les groupes est un moyen de mieux transmettre le judo, mais tous les clubs sont-ils aujourd’hui en mesure de se restreindre de leur plein gré sur leur nombre d’adhérents ? Il y a peut-être là matière à penser pour comprendre où en est le judo d’un pays, en l’occurrence le judo français.
Propos recueillis par Anthony Diao
Photos : Antoine Frandeboeuf
À nos lecteurs : cet article est paru en mars-avril 2020, dans L’Esprit du Judo n°85. Le magazine est disponible ici