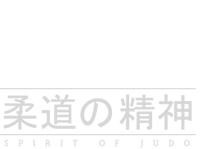Par Emmanuel Charlot
Au moment où je pose les premiers mots de cette chronique, je me sens léger. Il est 19h à Tokyo et je viens à l’instant de recevoir la confirmation que j’aurai bien le droit d’entrer au Budokan demain pour la première journée du judo. Enfin, si jamais le résultat de mon troisième test salivaire est arrivé à temps, demain matin, juste avant la compétition… et si il est négatif.
Mais je mesure déjà ma chance. En vadrouille du côté du club France aujourd’hui – nous avons le droit de sortir après trois jours de quarantaine — nous croisons non seulement le Président de la France, Emmanuel Macron, qui est l’un des heureux privilégiés de la cérémonie d’ouverture, mais aussi Stéphane Nomis, le Président de France Judo, et pour lui la réponse était négative pour les phases finales. Vous m’avez bien lu. Le président de la fédération française de judo s’est vu refusé l’accès au Budokan pour la phase finale de la première journée olympique du judo. Et il n’est pas le seul. De nombreux présidents de fédération sont dans ce cas, chacun dans leur discipline. Il y avait quelque chose de réellement effrayant à l’apprendre, alors que nous étions toujours dans l’attente d’une réponse.

Il faut comprendre ce que sont les fondements de l’aventure olympique pour un journaliste. Si il est relativement faisable de se faire accréditer pour un championnat d’Europe ou du monde de judo, l’accréditation olympique est d’une autre nature. Il ne suffit pas d’invoquer un vague statut de journaliste en ligne. Il faut avoir pignon sur rue, avoir fait ses preuves à travers le temps, être reconnu par le Comité National Olympique de son pays. C’est l’honneur d’une agence sportive de pouvoir prétendre à l’une de ces accréditations, le graal suprême étant de pouvoir en justifier plusieurs, et « tout sports » s’il vous plaît, plutôt que liée à une seule discipline.
Une fois ce type d’accréditation obtenue, il faut la défendre dans le temps en continuant à être journaliste (ce qui veut dire tirer l’essentiel de ses revenus de cette activité, ce qui est de moins en moins facile), concerné par les Jeux, en se rendant dans les pays hôtes et en faisant son travail sur une ou plusieurs disciplines. Il faut être crédible, convaincre qu’on a toujours la légitimité. C’est une bataille sur le long terme. Une bataille avant, et aussi pendant l’épreuve. Sur place, il y a toujours quelque chose de physique. Cela demande de la motivation et de l’endurance. On sait ce qu’on est venu faire là. Marcher sur des trottoirs sous le cagnard en traînant des sacs un peu trop lourds, passer des sas de sécurité de plus en plus nombreux, arriver tôt, et même très tôt pour être sûr de trouver une place, lutter contre le stagiaire japonais somnolent qui a collé à six heures du matin sur toutes les tables des cartes de visite de ses collègues moins matinaux, jouer des coudes, rester tard en se battant contre les responsables des salles qui veulent la préparer pour le lendemain, recommencer le lendemain en résistant à l’accumulation des nuits trop courtes… tout cela, c’est les Jeux, et c’est de bonne guerre.
Avec le système numérisé global mis en place par l’organisation de Tokyo 2020, cette bataille enthousiasmante, excitante, qui nous ramène au plaisir de faire ce que nous faisons, nous est confisquée. J’ai cinq Jeux olympiques derrière moi, j’ai fondé une revue sur le judo (avec mon camarade Olivier Remy, lequel a dû renoncer d’entrée à ces Jeux pour lesquels rien n’était sûr), j’ai une accréditation « tout sports », et même plusieurs, j’ai payé des billets d’avion, des chambres d’hôtel, assumé un budget conséquent… mais quelqu’un, quelque part, peut décider si j’ai le droit ou non d’entrer dans la salle où va se dérouler le judo ! Je dois attendre la veille pour qu’on me dise ce qu’il en est. Bon, pas bon. Et finalement — c’est la sinistre puissance de « l’enjeu sanitaire » — je l’accepte implicitement. Qu’aurais-je fait si on m’avait refusé cette entrée demain ? Je vous avoue que je n’en sais rien. Il y a quelque chose d’impensable là dedans. Et si après demain ou dans trois jours cette entrée m’est cette fois refusée pour une raison qui m’échappe ? Quels sont les critères d’ailleurs, que ce desk énigmatique met en avant pour décider qui peut et qui ne peut pas ? Ici, ce n’est pas Skynet, mais ICON, ou l’une de ces déclinaisons. Les critères d’avant, je viens de les décrire, je les connais bien : une accréditation précieuse comme un titre nobiliaire et la motivation d’être là, de ne rien rater. Les critères d’aujourd’hui, quels sont-ils ? Je suis accrédité, mais pas sûr de voir ce que je souhaite voir ? Pas sûr de pouvoir faire mon métier ? Que faire en cas de refus ? Un scandale ? Nous n’avons même pas le droit de prendre les transports en commun, ou un taxi, pour nous rendre à la salle…

C’est l’autre aspect un peu fou de cette organisation sportivo-sanitaire de Tokyo 2020. Notre hôtel actuel est à six kilomètres environ du Budokan, soit à peine un quart d’heure de voiture. Mais nous n’avons le droit qu’aux navettes officielles, lesquelles nous amènent tous vers le grand centre média que les Japonais ont installé… dans le port industriel de Tokyo, isolement et aération obligent, j’imagine, à plus d’une heure en bus de notre hôtel. Une fois arrivé, il suffit de trouver la bonne navette pour… remonter vers le Budokan, à plus d’une heure de là ! Quatre heures de transport par jour pour faire deux fois six kilomètres, c’est beaucoup. Heureusement ces jeux kafkaïens se présentent un peu comme un « escape game » où il s’agit de trouver les bonnes clés, non pas pour sortir, mais pour rester. L’information secrète ? La possibilité de commander la veille des taxis spécifiques à l’organisation Tokyo 2020, une fois inscrit sur une liste.
Tout s’arrange alors. Demain, nous devrions pouvoir entrer dans cette salle familière du Budokan, trouver nos places et faire ce que nous aimons faire depuis tant d’années, voir l’élite du judo mondial s’exprimer et pouvoir vous en parler.
Sauf, bien sûr, si le résultat de nos derniers tests n’est pas arrivé. Ou si l’un ou l’autre est positif, ou cas contact.
pour l’instant, à vingt et une heure, nous n’en avons toujours qu’un sur les trois. Mais nous y croyons bien sûr. Demain, nous y serons. Après-demain ? Ce sera un autre jour.