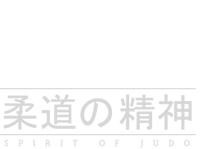Entretien avec Laurence Blondel (version longue)
En complément au dossier « Judo et études – Le grand écart, vraiment ? » à lire dans l’EDJ79 daté de mars-avril 2019, vous trouverez ici la version longue de l’un des nombreux entretiens menés au coeur de la matrice auprès de responsables qui s’efforcent de nous éclairer sur cette thématique ample et touffue.

©DR/L’Esprit du judo
Laurence Blondel est responsable à l’INSEP de l’accompagnement à la définition des projets de formation/professionnels des sportifs de haut niveau. Ancienne coureuse de 400 m sous les ordres de François Pépin, période Marie-José Pérec, elle jongle quotidiennement avec des réalités complexes nécessitant pédagogie, psychologie et esprit de décision. Entretien.
« Pas de sport sans études, pas d’études sans sport ». Qu’englobe exactement le terme double projet ?
Le terme double projet remonte aux années 2004. Il est lié à une volonté politique de sécuriser le métier de sportif de haut niveau par la mise en place de formations ou par le travail sur la professionnalisation du sportif. Être sportif de haut niveau, cela demande le même engagement que pour un métier mais, à part les sportifs professionnels, il est très difficile de vivre de son activité sportive. Il est donc important de développer d’autres compétences, tout en ne perdant pas de vue le fait que les compétences des sportifs de haut niveau sont transposables ailleurs. C’est un capital, une richesse.
C’est donc une réussite dans la vie qui se bâtit grâce au sport…
C’est vrai que, dans les faits, le terme « double projet » est un peu erroné car nous travaillons surtout le projet global du sportif, et celui-ci prend des colorations différentes selon les moments de sa carrière. Il faut y lire une volonté de sécuriser l’après en activant les bons leviers pendant. La trajectoire d’un sportif n’est surtout pas linéaire. Il y a un continuum à assurer, quitte à même parfois devoir concilier les inconciliables.
Comment cela fonctionne, au quotidien ?
Le process s’est affiné avec le temps. Il concerne désormais tout sportif entrant en pôle France ou à l’INSEP. Nous organisons cela avec l’ensemble des différents pôles France, auxquels j’envoie des questionnaires à l’attention des potentiels entrants. L’idée est de les identifier au plus tôt – dès décembre par exemple pour le tir à l’arc – afin de pouvoir mettre rapidement en place une structure d’accompagnement autour de chacun d’eux et travailler sur chaque projet sportif. Nous menons des phases d’entretiens avec des tests avec le responsable du pôle, l’entraîneur national et parfois les parents. Nous nous réunissons tous ensemble autour de la table et déterminons le but, les moyens et le chemin pour l’atteindre. Nous sommes dans une logique de sens, de dialogue et de bonne volonté. Mais attention : en bout de course, c’est le sportif qui prend sa décision.
Quelles opportunités offre ce dispositif ?
Le champ des possibles est immense. Il se décline en allègement, dédoublement voire triplement d’années, car il faut bien comprendre que le haut niveau demande un entraînement biquotidien voire triquotidien. Nous avons par exemple des liens privilégiés avec le Rectorat de l’académie de Créteil. Il y a une vraie concertation entre le monde du sport, l’Éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche. Nous avons notre propre lycée dans l’enceinte de nos murs. Xavier Dallet, le principal, peut s’enorgueillir de 100 % de réussite au bac avec 75 % de mention. Par ailleurs, 75 % de nos formations s’effectuent à l’extérieur de l’INSEP voire à distance, notamment le tertiaire, et des passerelles avec l’Université Pierre et Marie Curie existent pour aller sur des parcours d’ingénieur. Intramuros, nous proposons les filières STAPS ou Sportcom. [NDLR : malgré nos demandes, la FFJDA n’a pas souhaité communiquer davantage de statistiques pour étoffer le présent dossier.]
Le judo s’inscrit donc dans le cadre d’une problématique bien plus vaste…
L’INSEP reste le temple du haut niveau. Ce sont 600 sportifs par an répartis sur 26 pôles olympiques, que nous accompagnons depuis leur entrée jusqu’à leur sortie. C’est le principe de réalité et la nécessité d’anticiper qui gouvernent les choix. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Nous sommes accompagnateurs, pas psys, même si nous travaillons avec eux en étroite collaboration. La concurrence est âpre, et nous devons être très attentifs aux sportifs qui nous sont adressés. Dans le même ordre d’idées, il est important d’être à l’écoute des axes stratégiques d’une fédération.
Qu’en est-il du statut des partenaires d’entraînement ?
Les sports de combat, par essence, impliquent effectivement d’être deux. Il y a un échange permanent avec Anne Morlot, Arnaud Perrier, Gévrise Emane, Stéphane Traineau, Frédéric Lecanu, Christophe Gagliano ou Christophe Massina. Il est important de voir ce qui se passe sur le terrain, sur les lieux d’excellence. Dans le même ordre d’idées, depuis 2015, il y a l’obligation d’avoir un référent pour le suivi socio-professionnel. Cela participe d’une volonté de resserrer les moyens autour du très, très haut niveau, mais aussi d’accompagner ceux qui restent : les fameux partenaires, sans qui les n°1 ne seraient sans doute pas là où ils en sont. Sur ce sujet, une étude de l’INSEP a été menée à Rio. Elle a fait apparaître deux choses. D’une part, le sportif de haut niveau a besoin d’être allégé pour être disponible, mais aussi il a besoin d’autre chose. Pour certains, cet équilibre passe par le besoin de s’aérer. Pour d’autres, c’est déjà juste de pouvoir « croûter ». Mais leur point commun à tous, c’est que les blessures ouvrent malheureusement les yeux sur la nécessité de prévoir des plans A, B et C. Quelle est leur envie fondamentale ? Qu’implique la sortie des listes de SHN ? C’est à toutes ces questions que nous nous efforçons d’apporter des réponses claires et circonstanciées.
Comment organisez-vous vos journées ?
Je suis là pour travailler sur le projet. Ma porte est ouverte du lundi au vendredi, et je suis en surbooking permanent, ça ne désemplit pas. Le temps se partage entre le bureau, le terrain et les moments informels à la cafétéria par exemple, où des choses très fortes se disent. Il faut veiller à être dans la proximité sans être dans le copinage. Je n’ai pas de liens en revanche avec les clubs car, même si cela part souvent d’un très bon sentiment, il s’agit du secteur privé et moi je représente un organisme d’Etat.
Quel regard portez-vous sur la génération actuelle ?
Je sens cette génération particulièrement soucieuse de son avenir professionnel. Ce n’est pas du tout la même chose qu’il y a quinze ans. C’est la génération Y : ils sont réactifs, avec une forte sensibilité entrepreneuriale. Ils ont bien compris l’importance de pérenniser leurs sources de revenus. Je trouve cela rassurant.
Comment l’organisation française est-elle perçue, depuis l’étranger ?
Il se trouve que je représente la France dans un board à l’échelon européen, appelé l’EAS (European Athlete Student). C’est l’occasion de s’apercevoir que le modèle français est quasi unique. Ailleurs, c’est du cas par cas, avec un resserrement sur l’élite. Les Japonais nous interrogent, les Chinois également, eux qui jusqu’ici venaient surtout pour étudier nos équipements. Ça leur pose question, ils nous observent, y puisent des réflexions et des réponses. Les plus proches de nous dans l’accompagnement restent les Danois et les Belges.
Est-ce facile de déconnecter, lorsque l’on occupe de telles fonctions ?
La charge mentale – pour reprendre l’expression du moment – est considérable car j’ai conscience de ma responsabilité. L’humain est trop important. Toutes proportions gardées, nous avons parfois l’impression d’être le dieu Atlas qui porterait le monde sur ses épaules. C’est un travail de l’ombre, colossal. Le soleil ne se couche jamais sur la formation, et la tendance est grande de vouloir tout gérer. Après, j’ai la chance d’avoir une vraie écoute à la direction générale. Le responsable du pôle reste notre interlocuteur privilégié, et il y a de belles satisfactions, souvent.
Vous avez un exemple précis en tête ?
Je pense à une fille comme Margaux Pinot, par exemple. Il y a sans doute un lien de cause à effet entre son déclic à l’école et son déclic sur le tapis, il y a quelques mois. Le haut niveau, c’est un déséquilibre permanent. Aider les athlètes à (re)trouver un équilibre, c’est un métier, une responsabilité et, quand ça s’articule bien, une fierté.
À lire également sur ce site la version longue d’un entretien avec Philippe Martin, enseignant en EPS à l’Université Grenoble-Alpes, membre de l’équipe technique régionale de la ligue AURA, et responsable et entraîneur du CUFE judo ; les témoignages d’une demi-douzaine d’athlètes étrangers, actifs ou jeunes retraités ; l’exemple d’une reconversion ambitieuse de judokas de haut niveau avec un zoom sur la création du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Epsilium…