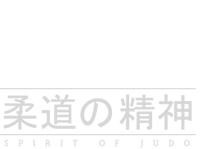Aujourd’hui, c’est la pluie. Tous les matins à la télé, on peut voir des hommes en chemise à l’air sérieux manier de longues baguettes avec un pompon jaune au bout, comme une balle de tennis, expliquant sans doute avec précision sur des cartes numériques les circonvolutions du typhon en approche. Typhon, ouragan, cyclone… de jolis mots venus de différentes régions du monde pour désigner la tempête dopée, celle qui se met à tourner comme une toupie sur elle-même et à générer des vents de folie. Il semble que nous devons nous préparer nous aussi à ces plateaux télés qui analysent ces formations météos qui ont de l’avenir.
Comme une maison de famille sur l’océan, le Japon est le dernier bout de terre habitée au bord du monde. Derrière il y a tout, devant, plus rien. L’immensité du « continent » Eurasie dans son dos, l’infini du Pacifique venant lécher ses rives. Paysans, guerriers… mais surtout marins et pêcheurs dans l’âme, les Japonais sont toujours sur le pont face au vent, aux aléas non tempérés du climat. Il fait froid en hiver, chaud et humide l’été. L’eau n’est jamais loin et elle est toujours agitée, la terre bouge ici comme un ponton sur la mer.
En ce moment c’est la saison des monstres, qui naissent au large. En 2019 le typhon Hagibis avait empêché l’organisation de quelques matches de poule de la coupe du monde de rugby. Après « In-Fa », qui a touché les petites îles du sud ces derniers jours – images de rafales de pluie et de panneaux tombés au sol à la télé – « Nepartak » s’attaque à Tokyo et pourrait, dit-on, perturber les épreuves de voile et a obligé le grand Teddy à se rapprocher plus tôt que prévu de Tokyo. Pas de quoi tout de même faire perdre l’équilibre à notre monstre à nous, notre « « kami » national. Les Japonais, eux, ont l’habitude et ne s’en émeuvent pas plus que ça. Pays éminent pratique où chaque élément du quotidien le plus prosaïque semble avoir été pensé ici avec plus de soin qu’ailleurs (leurs toilettes en sont le meilleur exemple), les Japonais ont l’arme absolue contre les effets de la tempête : le parapluie. Ici ce n’est pas vraiment un produit de consommation, juste un objet usuel quasiment collectif, souvent abandonné dans les récipients qu’on trouve à l’entrée de tous les lieux publics. Bonne idée, le parapluie japonais est transparent, ce qui permet de faire face au vent tout en continuant à voir où on met les pieds. Quand un Européen en achète un opaque et pliable, comme il en a l’habitude, il y a bien des chances que ce soit en fait… une ombrelle, très utilisée ici pour échapper à l’implacable soleil.

Nous n’en avions pas hier soir quand, en nocturne, nous sommes rentrés du Budokan après la longue journée de compétition. Le temps dont nous disposons est limité : nous sommes de retour à l’hôtel après minuit et nous le quittons tôt le matin pour être sûr de pouvoir nous installer sans trop de concurrence journalistique. Entre temps, il faut trouver de quoi manger, ce que nous faisons en filant au plus vite vers notre restau de ramen habituel avant la fermeture de la machine à commandes (au Japon, tout se passe par écran interposé) celui de nos premiers « take away » chauds des débuts, dernier estaminet ouvert à cette heure tardive. Il récupère quelques noctambules échauffés par l’alcool, des célibataires fatigués, des travailleurs des chantiers de nuit et, invariablement, deux journalistes français juste après minuit. Depuis quelques jours – peut-on l’avouer ? — c’est sur une table que nous mangeons nos nouilles au bouillon et nos gyozas. Si c’est l’état d’urgence au Japon jusqu’à la fin des Jeux, on ne sent ici aucune anxiété. Comme avec les typhons, les Japonais ont une meilleure habitude que nous des virus respiratoires.
Hier au soir, nous étions donc dans l’idée de braver les premières gouttes avec nos sacs « Tokyo 2020 » sur l’épaule pour arriver dans les temps à notre lieu favori, mais la pluie ici ne ressemble pas aux ondées parisiennes. Elle tombe tout droit et sans temps mort, comme lorsqu’on tourne le robinet d’une douche au large pommeau. C’est doux, mais inéluctable. En moins d’une minute, on est transpercé. Heureusement, il continue à ne pas faire froid.
Notre rituel est immuable depuis sept jours. Départ au matin en taxi – pour les navettes, il faut oublier — arrivée au Budokan à l’entrée officielle, bordée d’innombrables pancartes, feux de circulations provisoires, eux-mêmes renforcés par des bénévoles en gilets fléchés lumineux quand vient la nuit. Une fois sur deux, le taxi n’a pas affiché son autorisation officielle — les Jeux n’ont pas beaucoup impacté une population qui a d’autres chats à fouetter — et nous devons le quitter rapidement tandis que le préposé à la vérification déchaîne sur le chauffeur une sorte de protestation mécanique. Ce matin du septième jour, pris sous une averse drue, nous étions bien heureux d’avoir nos parapluies japonais achetés vers deux heures, après le restau, au Seven Eleven. Arrivés dans les premiers, nous pouvons brocarder nos camarades moins prévoyants et donc trempés comme des soupes nippones. On s’amuse comme on peut.

Il y a une étrange démonstrativité dans ces barrages de contrôle. Comme si il était plus important ici de glorifier, de célébrer le fait d’organiser, plutôt que l’organisation elle-même. Chaque check-point est une cérémonie. À Atlanta en 1996, les Américains avaient fini par développer une forme de mauvaise humeur policière, peu habitués qu’ils étaient à des formes culturelles, des réactions inhabituelles à leurs yeux. Quelques journalistes étrangers avaient fait les frais de cette dissonance cognitive par un tour en cellule. Au Brésil en 2016, les cohortes de bénévoles avaient rapidement fondu comme neige au soleil, dégrisés très vite par la dimension fastidieuse du job. Au bout d’une semaine, tout le monde était à la plage. C’est toujours le tempérament collectif, ses forces et ses limites qui sont mises à l’épreuve par de telles aventures. Qu’en sera-t-il à Paris en 2024 ? Je suis curieux de le découvrir. Ce sera une occasion de se connaître. Ici, il y a les policiers, calmes et bien campés sur leurs jambes de judokas ou de kendokas – on peut s’amuser à les reconnaître à la morphologie, et aussi à la façon dont certains s’appuient avec aisance sur leur bâton long, arme intimidante dans des mains expertes. Il y a les bénévoles de tous âges qui vous apostrophent de loin pour vous indiquer une route que vous connaissez déjà pour l’avoir emprunté deux fois par jour depuis le début, l’escalier sur lequel vous vous apprêtez à monter, ou pour vous protéger du risque imaginaire d’être renversé par un bus qui n’est pas là, parce que vous avez mis un pied sur la chaussée. On vous salue avec régularité avec la formule chantante qui accompagne, et cette raideur spécifique, faite pour montrer qu’il s’agit bien d’une forme ritualisée. En Occident, l’élégance consiste à faire passer les gestes de politesse pour une expression naturelle. Au Japon, c’est l’inverse. Plus on en rajoute dans le faux, mieux c’est perçu. Comme chez nous, derrière il y a le sourire, vrai ou pas. Quelques contacts diffus ont fini par se nouer. On dit les Japonais polis, c’est vrai. Ils sont aussi souvent gentils, ce qui n’est pas la même chose. Sans doute que la forme finit par travailler le fond. Les bénévoles seront là jusqu’au bout, bien sûr, pour montrer au monde peut-être la force du peuple japonais, mais surtout pour être plusieurs, à faire ce qu’ils ont toujours fait depuis l’école, le sujet caché dans tous les scénarii de manga de super-héros ou d’apprentis ninjas : bien faire ensemble, avec les autres.

Dans la salle, ils sont partout pour vous indiquer le chemin ou simplement vous saluer quand vous déambulez dans le coin. Cela ne leur vient pas à l’idée en revanche de passer le soir dans les tribunes de presse abandonnées par les journalistes pour ramasser les détritus abandonnés. Pas de « techniciennes de surface » indonésiennes en blouse pour faire le sale boulot. Au Japon, la propreté des lieux est l’affaire de tous. La première fois qu’on retrouve son gobelet sale ou son sachet de kit-kat abandonné, on est surpris, vaguement honteux. Le lendemain, on ne laisse rien sur la table.
Ce soir nous saurons si Teddy a finalement emporté son pari de triplé olympique. Il sera trop tard pour aller manger un ramen.

arigato gozaimasu !!