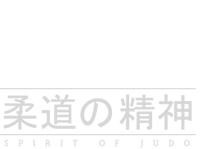Le dernier maître japonais fondateur du judo français nous a quittés
Shozo Awazu à l’ambassade du Japon en 2011 / Photo Emmanuel Charlot
Maître Shozo Awazu nous a quitté ce matin à 8h, à la veille de son 93e anniversaire.
Comme l’ensemble du judo français, nous apprenons le décès de Maître Azawu avec l’émotion qui accompagne non seulement la disparition des aînés aimés et respectés, mais aussi les changements d’époque. Cette disparition, au-delà même de la tristesse qu’elle suscite, a le poids fatidique que prend la dernière page d’un grand livre qui se ferme. Ce n’est pas celle du judo français bien sûr, mais peut-être celui de sa jeunesse. Shozo Awazu est en effet arrivé en 1950, au moment de la reconstruction de l’après-guerre, comme l’homme lige de Mikinosuke Kawaishi. Il n’a jamais cessé depuis de tracer le sillon rectiligne d’une vie entièrement consacrée à renforcer le jeune judo français, ses grands compétiteurs, mais aussi, encore plus essentiellement, ses principes éducatifs et moraux. Il est très certainement l’un des piliers forts de cette grande histoire singulière du développement exceptionnel du judo chez nous. Respectueux de son engagement irréversible et absolu au service du judo français, il était encore présent aux compétitions régionales et nationales jusqu’à ce que sa santé le lui interdise. Tous les gens avertis repéraient avec affection et gratitude sa silouhette de sage bienveillant et attentif, assis discrètement sur une chaise et appuyé sur sa canne, hissant par cette ultime abnégation son propre parcours à la hauteur d’un accomplissement. Désormais le maître est mort et le judo français, ceux qui ont appris avec lui, appris de sa rigueur, de sa force d’engagement et de son patrimoine technique, doivent lever leur lanterne pour continuer sans lui. Son exemplarité limpide nous manquera pour toujours.
Nous partageons très profondément la tristesse de ce moment, sa gravité. Nous sommes de tout cœur avec sa famille, avec ses proches et ceux qui l’ont entouré jusquà la fin.
Nous vous proposons de relire la dernière interview que nous avions fait avec Shozo Awazu pour l’Esprit du Judo n°36, paru en février 2012 :
SHOZO AWAZU, UNE VIE AU SERVICE DU JUDO FRANÇAIS
1923-2016
C’est un 6e dan un peu timide qui débarque à Marseille en été 1950. Il est là pour un an. Le respect qu’il doit à ses aînés ne lui a guère donné le choix. Il doit donner un corps à Kawaishi sensei, qui a dépassé la cinquantaine. C’est maître Kurihara de la Butokukai de Kyoto, où il fut le condisciple de Kawaishi, qui l’a désigné. Son arrivée est un événement pour le judo français qui n’a encore à peu près que Kawaishi comme référence. Profitant de l’énergie des 27 ans du nouveau venu, Mikinosuke Kawaishi organise une série de galas, dont celui de Paris, le 21 octobre au Vélodrome d’Hiver, qui fait date. Pour la première fois, le judo passionne les magazines et même la radio, pénètre la sphère du grand public. L’équipe de France de Levannier, Martel, Belaud, Verrier, Roussel, Cauquil, Pelletier, Laglaine, Zin, puis le colosse De Herdt, qui sera le seul à obtenir le nul, rencontre le jeune combattant, bientôt leur mentor technique. Partenaire d’entraînement autant qu’entraîneur, Awazu paye de sa personne et travaille à construire l’équipe de France « moderne » qui surclasse toute l’Europe, et triomphe une nouvelle fois dans les médias lors des premiers championnats continentaux en 1951 à Paris. Henri Courtine et surtout Bernard Pariset seront ses plus célèbres élèves, emportant de nombreux titres européens et des médailles mondiales. Moins éblouissant qu’Abe, moins seigneur que Michigami, Awazu a pour lui d’être jeune et au cœur du système. Surtout, c’est un homme doux et respectueux, qui suivra toute sa vie la voie bouddhiste de non-violence, d’harmonie et de respect de l’autre, supportant sans se plaindre la vie difficile des premiers temps. Il ne reverra sa femme laissée au Japon que bien des années plus tard. Sans rien revendiquer, il donnera aux premiers combattants français la marque du judo de Kyoto et en particulier un domaine encore inexploré, le ne-waza. Lionel Grossain, triple champion d’Europe, en fut avec Bernard Pariset le premier bénéficiaire. Des générations de jeunes athlètes ont subi le cauchemar souriant de son ne-waza sans fioriture et simplement invincible.
Cette droiture modeste et cette constance fiable et fidèle, refusant toujours la tentation de l’indépendance, a fini par lui obtenir une place unique qu’il occupe toujours dans le judo français. Comme un symbole vivant au-delà du rôle d’expert technique, celui de véritable colonne vertébrale, de moelle épinière de notre aventure. À l’échelle de la vie d’un homme. La sienne.
L’Interview
À 88 ans désormais, le vieux maître du judo français répond aux questions de l’Esprit du Judo. Soucieux de vérité et de mémoire, Shozo Awazu, 9e dan, parle en toute franchise.
Comment êtes-vous arrivé en France ?
C’est maître Kawaishi, lors d’un voyage au Japon, qui avait demandé à son ami du Butokukai, Kurihara, de lui trouver un assistant. Ce fut moi.
Je suis arrivé à Marseille le 5 juillet 1950, après 28 jours de bateau. C’était un grand bateau, mais j’avais une toute petite place. Heureusement le maître de pont de la 1e classe était le père d’un judoka marseillais et m’avait permis d’y accéder. Deux jours après mon arrivée, j’ai fait une ligne de combats. C’était une erreur, je n’étais pas prêt physiquement. Au bout du 11e ou 12e combattant, j’ai perdu sur hiza-guruma. C’était Monsieur Oudart, aujourd’hui 8e dan, troisième du championnat de France à l’époque et spécialiste de ce mouvement, qui me l’avait porté. Par politesse pour moi, il ne s’est jamais vanté de ce combat, il n’en a jamais parlé. Mais je me rappelle de lui plus que des autres ce jour-là ! Et la France venait de me donner une première leçon. Quand le physique n’est pas là, l’esprit seul ne peut pas tout faire.
Qu’est-ce que vous y avez amené ?
C’était le début du judo français. Il était encore assez statique. Moi j’ai amené l’esprit de travail de ma région, le Kansai. À Kyoto, il y avait l’institut du Butokukai et son école militaire de Budo Senmon Gakko (Busen) qui était réputé pour sa valeur au combat. À 16 – 17 ans, je faisais partie de l’équipe de Kyoto et nous étions premiers du Japon. Notre travail n’était pas tellement joli, c’est vrai, mais nous cherchions l’efficacité. Nous faisions aussi beaucoup de ne-waza, mon école en particulier qui était spécialisée dans le travail au sol. C’est que j’ai amené à la France.
Comment jugez-vous la querelle des styles Kawashi – Abe ?
On parle beaucoup d’Ishiro Abe. Son travail était léger et élégant, mais ce n’était pas un champion comme les représentants du Kodokan Matsumoto et Yoshimatsu, qui sont passés en France à l’époque et qui ne faisaient pas le même judo. Abe cherchait le mouvement pour le mouvement et il a impressionné beaucoup de monde. Mais finalement, même Moreau et Beaudot, qui sont partis pendant deux ans au Kodokan, ne sont pas revenus plus forts que Pariset et Courtine, nos champions français, avec lesquels j’ai travaillé tous les jours pendant trois ans. Nous faisions un travail solide. Il fallait rester calme et attaquer au bon moment pour faire tomber et suivre au sol. Cela ne devait pas être si mauvais puisqu’ils ont été tous les deux troisièmes des championnats du monde. J’ai beaucoup côtoyé Ishiro Abe dans les fédérations européennes de judo et je pense qu’il a toujours eu en tête qu’il était le représentant du Kodokan. J’ai appris de mon côté à aimer le judo français.
Pourquoi la fédération n’a t’elle pas travaillée avec d’autres experts japonais à cette époque ?
Il y a eu d’autres Japonais en France à ce moment-là. Tokyo Hirano était plus jeune que moi de trois – quatre ans et c’était un bon camarade à moi. Il était dans l’équipe de Kyoto et avait été champion du Japon en lycéen. Il était très fort. C’est un sponsor américain qui l’avait amené en Europe. Il serait bien resté en France et la Fédération lui avait demandé, mais si Kawaishi n’était pas d’accord, alors ce n’était pas possible. Il est parti en Flandres en Belgique. Raymond Sasia avait un club à Paris et invitait aussi des Japonais. Il a fait venir notamment Maître Oda, l’un des plus grands experts de ne-waza du judo. Mais il était malade d’un cancer et son influence est restée limitée.
Il y a eu aussi Michigami. C’est un professeur de Bordeaux, par l’intermédiaire d’André Nocquet parti au Japon, qui a demandé un professeur pour son club à Kurihara, à Kyoto. Michigami est venu. Il était fort et titulaire du diplôme de Budo de Busen. Il était formé pour être un professionnel des arts martiaux. Mais j’étais déjà à Paris, sous le contrôle de Kawaishi.
Comment jugez-vous l’influence de Kawaishi sur le judo français ?
Kawaishi ne représentait pas le Kodokan. À Tokyo, le judo français n’était pas estimé à cause de cela et aussi à cause de sa méthode avec les ceintures de couleur. Mais en France, tout le monde était content. C’est important ça, sinon ça ne marche pas. Et après la guerre, même les ceintures marrons, voulaient devenir professeur. Il y avait beaucoup d’enthousiasme et de rêve chez les élèves de Kawaishi. À cette époque, Madame Curie venait assister aux tournois il y avait de l’intelligence dans le judo. C’est ce qu’a réussi Kawaishi.
La France a-t-elle le « style de Kyoto » en judo ?
Le judo n’appartient à personne, qu’à ceux qui travaillent. Kyoto, le Kodokan, tout le monde fait du judo dans un esprit de camaraderie. Il n’y a pas de Japonais ou de Français, il n’y a que des gens qui travaillent. Ceux qui ne le font pas ne s’améliorent pas. C’est simple. Au Japon nous avons 130 ans d’histoire du judo, 130 ans de théorie sur le sujet. On a une idée précise de l’essentiel. Pour améliorer la technique, il faut étudier les principes de base, kuzushi, orientation du déséquilibre, tsukuri, placement du corps, kake, attaque. Et le résultat est le seul barème. Après il y a mille manières de faire, mille façon de travailler des professeurs, mais à la fin, une question : est-ce efficace ou pas ? Si ça ne marche pas, il faut s’interroger.
L’esprit général du travail, c’est « Bunbu Ryodo », développer sa compréhension et sa connaissance au quotidien en même temps que l’entraînement. Se cultiver et pratiquer doivent avancer ensemble, voilà ce qui compte.
La France ne devrait-elle pas faire venir de nouveaux experts japonais ?
C’est difficile pour moi de répondre. Aujourd’hui la Fédération s’occupe de développer le judo français d’une autre façon. Ma génération était différente. Les Japonais étaient les seuls qui ne faisaient que du judo. La Fédération française s’est affranchie de cette tutelle parce qu’elle a désormais de bons professeurs et une culture importante du judo. Au Japon il y a les universités, mais en France il y a les clubs. Pour comparer l’efficacité des professeurs, il y les championnats du monde pour cela, et la France a des résultats, alors ce n’est peut-être plus nécessaire un Japonais en France. Un expert qui fait des stages c’est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut un professeur, qui s’engage quotidiennement, s’interroge sur ce qui ne va pas et soutienne l’entraînement de l’élève. Il faut bien étudier les détails. Japonais ou Français, ce n’est pas la question.
Que retenez-vous de votre longue histoire avec la France ?
Cela fait maintenant 60 ans que je suis là. Je n’ai pas de club privé. J’ai travaillé avec tout le monde en gardant l’esprit libre et ouvert. Tout le monde me connaît et me témoigne de la sympathie. Voilà ce qui me rend heureux. Si j’ai été exemplaire ? Je ne sais pas. J’ai avancé et des judokas m’ont suivi. « Que fait Awazu ? ». « Il va tout droit ». Alors tout le monde avance droit.